
Quatre étapes incontournables pour aider des personnes victimes de harcèlement

Le harcèlement est un thème récurrent d’articles et de discussions. Il est à prendre au sérieux au même titre que de la maltraitance.
Sa gravité n’est pas liée à la gravité des actes posés. Ceux-ci sont généralement anodins, mais à leur fréquence et à leur répétition dans la durée. C’est parce que ces actes sont anodins qu’il est difficile de les arrêter car difficile de les punir quand ils sont pris isolément.
Lorsque je travaille avec des personnes victimes de harcèlement, il y a plusieurs étapes incontournables :
1. Identifier en quoi ces actions apparemment bénignes sont du harcèlement.
2. Assurer la sécurité de la personne ; en l’invitant à s’écarter des personnes toxiques, ou en faisant intervenir des adultes lorsque les actions se passent dans le cadre scolaire.
3. Apprendre à la personne à se faire respecter en posant des limites et en les affirmer ces limites.
4. Aider à reconstruire son estime d’elle-même, en reprenant conscience de ce qu’elle est , de ce qu’elle aime faire, de ses talents propres, afin de pouvoir de présenter à l’autre consolidée par cette assurance intime.
Aucune de ces étapes n’est simple à mettre en œuvre, et chacune présente une urgence propre.
1- Identifier
Identifier qu’il s’agit bien de harcèlement, c’est aussi prendre conscience de sa propre vulnérabilité. Admettre que l’autre peut ne pas vous aimer, quand bien même rien de concret ne le justifie.
Le risque est alors d’atteindre plus profondément la confiance en soi. Ou bien de bloquer la personne dans une situation de victime.
2. Assurer la sécurité des personnes
Assurer la sécurité des personnes en intervenant est délicat. Un harceleur ne souhaite pas se reconnaitre comme tel. Il est pris dans un système pervers de négation des souffrances de sa victime. Se reconnaitre lui-même comme harceleur revient à voir en lui son côté noir, et à atteindre sa propre confiance en lui-même, voire à se confronter à ce qu’il n’aime pas en lui. Impossible.
Il va donc réagir non pas par l’excuse, mais par la négation des faits, voire par la surenchère. Il va donc reprocher à la victime sa « susceptibilité », le fait de l’avoir « dénoncé » le fait d’être « faible » etc…
- Dans le cas de harcèlement au collège ou au lycée, seule la fermeté des adultes peut faire stopper le harcèlement.
- Dans le cas d’un harcèlement au travail, la situation est encore plus délicate car il y a des enjeux de management, de carrière, ou juste de possibilité de maintenir une activité professionnelle.
- Il existe aussi des situations de harcèlement dans le cas de la séparation de couples. Il y a un harcèlement direct : envoi de messages, d’insultes, multiplication des procédures juridiques… Il y a aussi un harcèlement plus subtil, mais tout autant dévastateur, en accusant l’autre de ce que l’on fait soi-même, en diffamant son ex-conjoint, il y a création d’un vide autour de lui, qui constitue une forme subtile de harcèlement.
>> Dans le cas d’un harcèlement au collège il n’est pas rare que ce soit la victime qui finisse par quitter l’établissement. Notamment si l’autorité représentée par les adultes n’a pas mis les limites nécessaires. Un enfant ou un jeune en construction est a priori capable de modifier son comportement si les limites sont posées.
> Dans les deux autres cas c’est aussi une autorité supérieure qui devrait intervenir, bien qu’elle soit plus difficile à définir ou à mettre en œuvre que dans l’exemple du collège (supérieur hiérarchique, ressources humaines, ou bien justice).
Cependant, le harceleur étant souvent le plus habile verbalement, c’est souvent une fois de plus la victime qui s’efface. D’où l’importance d’accompagner la personne à se faire respecter par elle-même.
3. Apprendre à la personne à se faire respecter
Apprendre à la personne harcelée à se faire respecter, et retrouver l’estime de soi, relève généralement d’un travail psychothérapeutique, mais le rôle des proches est essentiel.
Pour mettre des limites il faut reconnaître où sont ses limites. Et ce qui généralement est une des plus grandes difficultés des victimes de harcèlement. Soit par manque initial de confiance en elle, soir par ignorance, soit parce que leur naturel aimable et ouvert les empêche de discerner l’excès, elles se laissent emmener à une sorte de point de non-retour où il devient extrêmement difficile pour elles de poser le stop qu’il est nécessaire de poser.
Au-delà de l’accompagnement psychologique, la personne a besoin de ses proches pour l’aider à discerner qui elle est, et en quoi son avis est important.La force des harceleurs est puisée dans la faiblesse de la victime. Bien souvent ils s’emparent de la place que la victime leur laisse, à son insu.Il s’emparent aussi de la tendance de la victime à vouloir faire plaisir, ou bien à rechercher la paix par le silence, hors « qui ne dit mot consent ». La seule réponse possible est une affirmation de soi, qui vient de sa propre légitimité retrouvée à ne pas se laisser faire, et à comprendre que sans cela, l’autre ne s’arrêtera pas. On est pas harcelé car on n’a pas de valeur, on est harcelé car l’autre est dans la recherche de pouvoir, et d’estime de lui-même puisée dans l’écrasement d’autrui et l’affirmation d’une fausse identité, mais reconnue par le groupe.
Plus la personne se démarque du groupe, en revanche, plus elle risque de se faire ennuyée par celui qui est déstabilisé par son originalité, et la force de caractère que présuppose cette autonomie. Généralement les personnes qui se font harcelées ignorent que leur force, leur identité propre est la source de cette agressivité, et croient au contraire qu’elles ne sont pas à la hauteur, et recherchent donc une reconnaissance que l’autre n’a pas l’intention de leur donner. Il faut apprendre à s’aimer soi-même…
Accepter d’interroger les processus de harcèlement est accepter que tout le monde n’est pas dans la bienveillance et dans le respect des identités de chacun, c’est aussi accepter le vide identitaire de personnes qui ne survivent psychiquement que dans des relations de conflits. La victime doit alors accepter l’idée, je devrai dire en premier lieu, concevoir, que le conflit généré par l’autre n’est en aucun cas lié à elles-même, mais est juste le besoin vital de l’autre d’exister par et pour le conflit, voire la victimisation.Elles sont la cibles d’une antipathie créée de toute pièce par une personne frustrée , et généralement frustrée d’elle-même. D’où la complexité pour mettre fin à ce conflit.
Le travail thérapeutique consiste à éclairer les enjeux psychiques des uns et des autres, à faire accepter à la personne harcelée qu’elle n’est pas responsable de l’agressivité de l’autre, qu’elle ne doit pas en attendre un changement d’attitude pour que le choses bougent, mais mettre en place les réponses adaptée qui feront bouger les choses : Désintérêt pour l’autre, capacité à ne pas se laisser envahir et à ruminer face à chaque attaque, création d’une distance émotionnelle, et d’une distance émotionnelle énoncée (voir par exemple la vidéo « Ces mots là je te le rends« ). Refuser de prendre à sa charge les collages identitaires négatifs que l’autre assigne (« tu es nul », « tu es moche », « personne ne s’intéresse à toi », « tout mon malheur vient de toi », « tu ne t’y prends pas bien », « tu ne sais rien faire »…. )
Se faire respecter de l’autre, passe par se respecter soi-même, identifier que l’on est digne de respect.
4. Aider à reconstruire
Pour aider votre enfant à retrouver sa légitimité, il y a une posture à prendre : Dans le moindre des actions de la vie, poser la question « qu’en penses-tu » « quel est ton avis » « que préfères-tu ? » tous ces petits moments réapprennent à la personne à se réaffirmer. C’est parfois très laborieux car justement la confiance en son identité est mise à mal, mais c’est nécessaire.
Poser un stop pour la personne harcelée, c’est aussi prendre le risque dans un premier temps d’une agressivité plus forte. Il n’y a pas de règle immuable car cela dépend des personnes en jeu. Généralement le harceleur va venir tester la solidité de celui qui « ose » d’un seul coup de rebiffer.
Utiliser un vocabulaire fort, parler fortement, accompagner son « ça suffit » d’une posture physique qui affirme et non qui quémande le respect nécessite d’apprendre à le faire, mais aussi de se sentir légitime pour le faire.
Ce qui est compliqué c’est aussi que cette affirmation de soi entraîne un risque de solitude encore plus fort.
Finalement le groupe a peur du faible, car le faible renvoie à chaque membre du groupe sa propre faiblesse. Alors le groupe laisse le harcelé seul, et n’aime pas quand celui-ci en dénonçant les faits dont il est victime induit qu’il n’a pas été aidé par les autres. C’est en cela qu’il y a une perversion des réactions de chacun et finalement un avilissement à celui qui semble le plus fort, même s’il tient sa force d’actes objectivement répréhensibles. Hors dans une situation de harcèlement ce n’est pas du tout l’objectivité qui domine mais la subjectivité et l’émotion.
Le rôle des proches est aussi d’être un soutien sans faille dans ce stress que la personne vit, dans la reconnaissance de sa détresse et dans la reconnaissance de sa légitimité à vivre autre chose.
>> Les femmes battues décrivent bien leur impossibilité à penser qu’elles ne devraient pas vivre autre chose, lorsqu’elles expliquent que si elles ont subi telle ou telle violence, elles en étaient certainement responsables d’une manière ou d’une autre.
>> Les lycéens victimes de harcèlement sont capables de tenir le même genre de discours.
>> Les séparations de couple, il faut parfois une dose immense d’agressivité du conjoint dominateur pour que le conjoint dominé finisse par réagir. Et même dans ce cas là ce n’est pas toujours très évident, sa réaction peut prendre des moyens détournés qui permettent encore au conjoint dominateur d’affirmer son bon droit. Et d’être approuvé pour cela par le groupe.
Les effets du harcèlement sont terribles et profonds sur l’estime de soi, et créent une véritable vulnérabilité. Je pense en écrivant ces lignes à une jeune personne qui était prise dans une relation amoureuse déséquilibrée. Elle n’a pu retrouver de la distance dans cette relation, qu’après une séance extrêmement éprouvante durant laquelle nous sommes revenues sur le harcèlement dont elle avait été victime 3 ans auparavant. En réalité elle en avait gardé inconsciemment l’idée qu’elle devait se soumettre au désir de l’autre, car elle n’était pas intéressante, l’autre lui faisait donc un cadeau inestimable en s’intéressant à elle. Dans cette situation qui s’est heureusement bien finie, cette personne se mettait à la merci de l’autre dans la relation.Son ami n’était pas malhonnêtes, et n’a donc pas été malhonnête avec elle. En tant que thérapeute je ne comprenais pas pourquoi malgré un travail assez poussé, la situation sur cette relation pourtant terminée restait bloquée, je ne comprenais pas pour quoi cette personne n’arrivait pas à se considérer par elle-même dans ce couple, et dans toutes ses projections sur le « couple idéal ». C’est à partir du moment où par un travail psycho-corporel elle a symboliquement rendu à ses anciens harceleurs leurs remarques dévalorisantes, qu’elle a pu restaurer son estime d’elle-même et rétablir un équilibre satisfaisant dans ses attentes vis-à-vis des autres.
Le meilleur service que l’on peut rendre à ses enfants pour les prémunir de ce type de prise de pouvoir pour eux est de renforcer leur légitimité d’êtres pensants, existants, ayant le droit à leur place dans le monde. Cela va à l’encontre des injonctions telles de « sois sage », « fais toi oublier », au profit de « quelle est ton opinion » « qu’est ce qui compte pour toi »…
Pour aller plus loin sur la confiance en soi
Identifier sa relation à soi et aux autres
Poser ses limites pour retrouver sa sécurité intérieure
Développer l’autonomie de l’enfant en l’aidant à construire sa sécurité intérieure
 Au fil de ses 15 années d’exercice libéral, Aude a fait évoluer ses propositions thérapeutiques. Le fil directeur est une approche humaniste, basée sur les besoins de la personne, dans une dynamique interactive.
Au fil de ses 15 années d’exercice libéral, Aude a fait évoluer ses propositions thérapeutiques. Le fil directeur est une approche humaniste, basée sur les besoins de la personne, dans une dynamique interactive.
Progressivement Aude a développé la méthode de Relaxation Profonde Active. Basée sur l’exploration des sensations du corps comme vecteur d’information, suivi d’un protocole de réparation, de consolation ou d’acceptation selon les situations rencontrées. Cette méthode permet d’aller beaucoup plus loin dans la compréhension historique du patient, que ce qu’il sait en conscience.
Ces outils sont conçus pour être intégrés à une clinique traditionnelle intégrative.


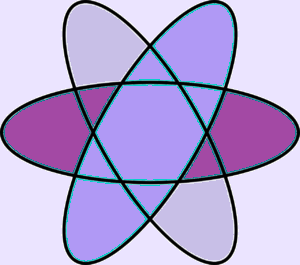

 Il est possible que votre enfant se comporte parfois avec nervosité et que cela vous tape sur les nerfs : il a du mal à se calmer et à se concentrer sur ce qu’il a à faire.
Il est possible que votre enfant se comporte parfois avec nervosité et que cela vous tape sur les nerfs : il a du mal à se calmer et à se concentrer sur ce qu’il a à faire.

