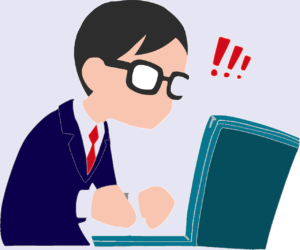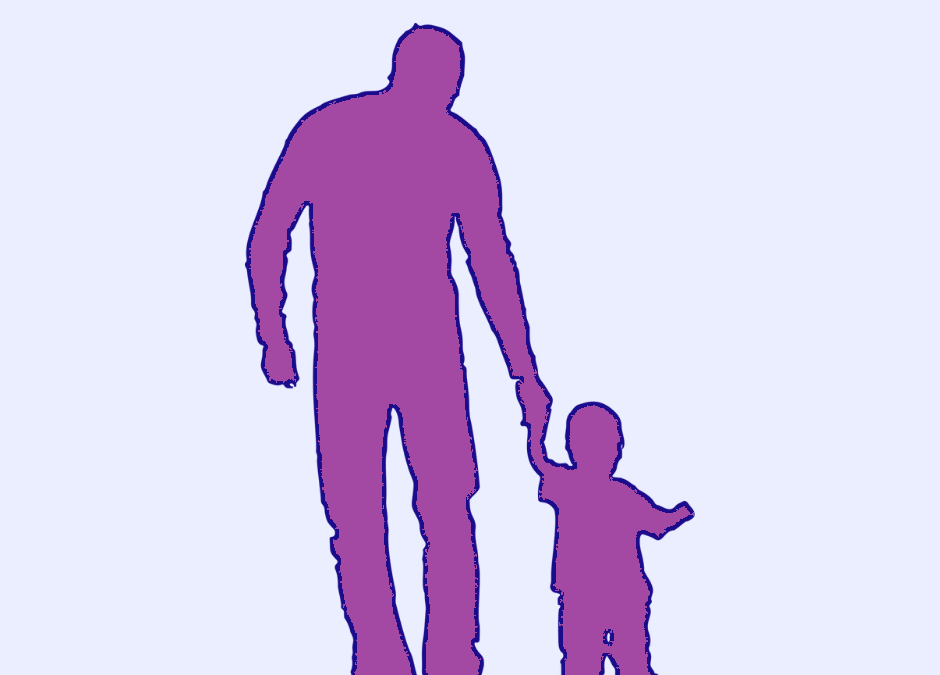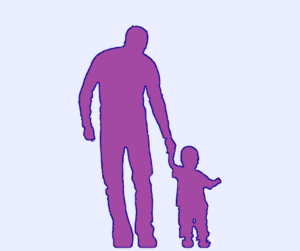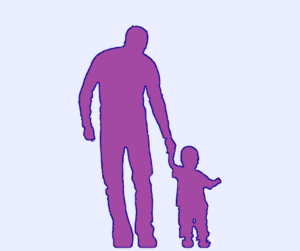
Les jeunes parents le savent bien : à deux ans, l’enfant a facilement tendance à dire « Non »… Toutefois, au lieu de vulgariser ce comportement, je leur conseille plutôt de le questionner : que signifie exactement cette opposition ? Que leur dit-elle sur leur enfant ? Des questions auxquelles je vais vous répondre ci-dessous.
Pour quelles raisons votre enfant dit-il « non » ?
Bon nombre de parents l’auront sans doute remarqué : l’anniversaire des 2 ans de leur enfant est souvent le début d’une phase au cours de laquelle il a tendance à refuser des choses, à dire « non » à longueur de temps, voire même à s’opposer à ses parents en hurlant et en faisant des colères.
Surpris et parfois dépassés, les parents ont tendance à réagir en supportant le comportement de leur enfant et en se disant que cela finira bien par passer. Cependant, en s’intéressant au sens que ce comportement peut avoir, le parent pourra y répondre de manière adaptée et ainsi de rétablir la paix et la quiétude au sein de la sphère familiale.
John Bowlby, célèbre psychiatre et psychanalyste britannique du XXème siècle, s’est intéressé à cette question et a développé une théorie dite « de l’attachement » dans laquelle il fait un lien entre ce comportement de refus de l’enfant et sa construction identitaire. Il explique en exprimant son refus par le « non », l’enfant cherche en fait à marquer sa différence avec les adultes.
Cette position renforce l’idée :
- que l’adulte est perçu comme donneur de soins et référent aux yeux de l’enfant,
- qu’il joue un rôle essentiel dans sa la construction de son identité, de sa personnalité.
L’adulte participe également au mode de négociation que l’enfant va utiliser entre son désir et celui des autres, à la régulation de ses émotions, au relationnel de l’enfant avec autrui.
En sachant cela, le « non » de l’enfant peut alors être perçu comme une expression d’affirmation dans sa construction identitaire et non plus comme une expression de son opposition. Ce qui va radicalement changer la réponse que ses parents vont alors pouvoir lui apporter !
Ainsi, quand leur enfant dit « non », ses parents peuvent se saisir de cette occasion pour :
- prendre du recul face à la situation et de se montrer moins emporté dans leurs émotions,
- aider l’enfant à prendre conscience de lui-même, de sa position sociale, de ses désirs, et permettre ainsi sa meilleure intégration dans les groupes sociaux auxquels il sera confronté tout au long de sa vie (crèche, école, vie affective, vie professionnelle, etc.).
Il est courant que les parents pensent que l’enfant qui dit « non » fait en fait un caprice ou une colère. Mais à deux ans, il faut savoir que l’enfant n’est pas encore en capacité de faire le lien entre ses actes, les réactions de ses parents et le pouvoir qu’il détient sur ces dernières. Il est encore trop autocentré pour manifester autant d’intentions dans ses prises de position.
Toutefois, il faut prendre en compte que le quotidien de la vie de famille peut être très perturbé par cette phase d’opposition qui peut se manifester pour tout et n’importe quoi :
- la forme et la couleur du bol pour le petit-déjeuner,
- le fait de donner la main à ses parents en allant à la crèche,
- le choix du pantalon ou de la robe à porter dans la journée,
- etc.
Des situations qui peuvent rapidement dégénérer et vous mettre, parents, dans le désarroi.
Comme nous l’avons vu plus haut, pour répondre à l’enfant, l’une des premières choses à faire est de se dire que cette opposition est en fait une affirmation de l’identité de l’enfant. La réponse a y apporter doit alors être choisie de façon stratégique. Je vous conseille :
- de ne pas permettre à l’enfant de choisir entre plusieurs possibilités,
- au contraire, de lui donner le choix tout en acceptant la possibilité qui aura été retenue par l’enfant.
Comment éviter le refus systématique de l’enfant au quotidien ?
L’une des stratégies à adopter va être de ne pas permettre à l’enfant de choisir en lui imposant une situation à laquelle il devra se conformer. Par exemple, en disant : « Tes vêtements sont sur ton lit » ou encore « Ton couvert est mis, tu peux commencer à manger ». En disant cela, l’enfant n’aura pas l’occasion de dire ce qu’il en pense et de dire s’il est d’accord ou non.
Vous pouvez également permettre un « semi-choix » à votre enfant. Au lieu de lui demander son avis sur une activité par exemple : « Veux-tu aller promener au parc ? », donnez-lui le choix entre deux possibilités : « Nous allons au parc. Préfères-tu aller voir les cygnes ou aller faire de la balançoire ? » Ainsi, votre enfant pour s’exprimer sans forcément s’opposer.
Certaines situations peuvent être compliquées à gérer. Dans ces cas, je vous propose quelques solutions pour maintenir la paix dans votre foyer et une relation constructive avec votre enfant. En fonction de ce que vous attendez de la part de votre enfant, choisissez la formulation adaptée :
- si votre enfant dit « non », demandez-vous s’il est essentiel que vous demeuriez ferme sur votre position ou non. Si vous changez d’avis, expliquez alors à votre enfant qu’elles en sont les raisons. Vous lui montrerez ainsi que changer d’avis ne signifie pas pour autant perdre son identité. Vous pourrez également lui expliquer la motivation de votre changement de position : « Très bien ! Je suis d’accord pour que tu portes le pull bleu au lieu du vert si c’est ce que tu souhaites. Tout compte fait il ne fait bon aujourd’hui, le vert serait peut-être un peu trop chaud pour la saison. ».
- vous pouvez aussi comprendre et accepter un désir de l’enfant en ajoutant : « Je crois que tu me demandes de la brioche au lieu d’un bol de céréales parce que tu n’aimes pas beaucoup ces céréales …».
- vous pouvez bien sûr vous opposer à une demande de votre enfant en expliquant le motif de ce refus : « Tu dois me donner dans la main parce que je ne veux pas prendre le risque que tu glisses sur le trottoir et que tu te fasses mal. ».
- ou bien encore verbaliser ce que l’enfant ressent : « Je crois que tu es en triste car tu aimes bien jouer avec ton copain et que tu ne veux pas le laisser. Mais là, il est tard, nous devons rentrer à la maison pour préparer le dîner. ».
Si l’enfant se met en colère, la réponse à apporter sera plutôt de le renseigner sur ses émotions plutôt que de justifier si on doit acheter ou non tel ou tel chose, en disant par exemple : « Tu es en colère. » ou « Je crois que tu es fatigué alors du coup tu es énervé parce que je te dis non », ou encore « Il me semble que tu as faim, nous allons rentrer à la maison prendre un goûter et ensuite nous verrons ce que nous ferons. »
Ainsi, en choisissant d’adopter telle ou telle posture, vous allez montrer à votre enfant que vous n’avez pas « peur » de ses réactions. Pour cela, vous devez avoir confiance en vous et en votre légitimité. Vous n’aurez alors pas besoin que votre enfant vous obéisse en tout point pour vous rassurer sur votre autorité parentale. Vous pourrez alors :
- ouvrir le champ des possibles à votre enfant,
- faire des propositions et être maître de la situation,
- permettre à chacun d’être gagnant/gagnant (vous réalisez un projet familial/votre enfant affirme son identité par le choix entre deux alternatives proposées),
- enrichir la capacité de votre enfant à s’affirmer autrement qu’en disant non et ainsi de développer son mode de pensée.