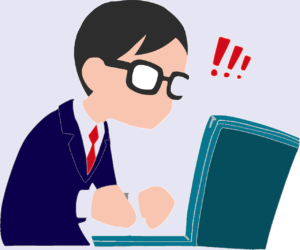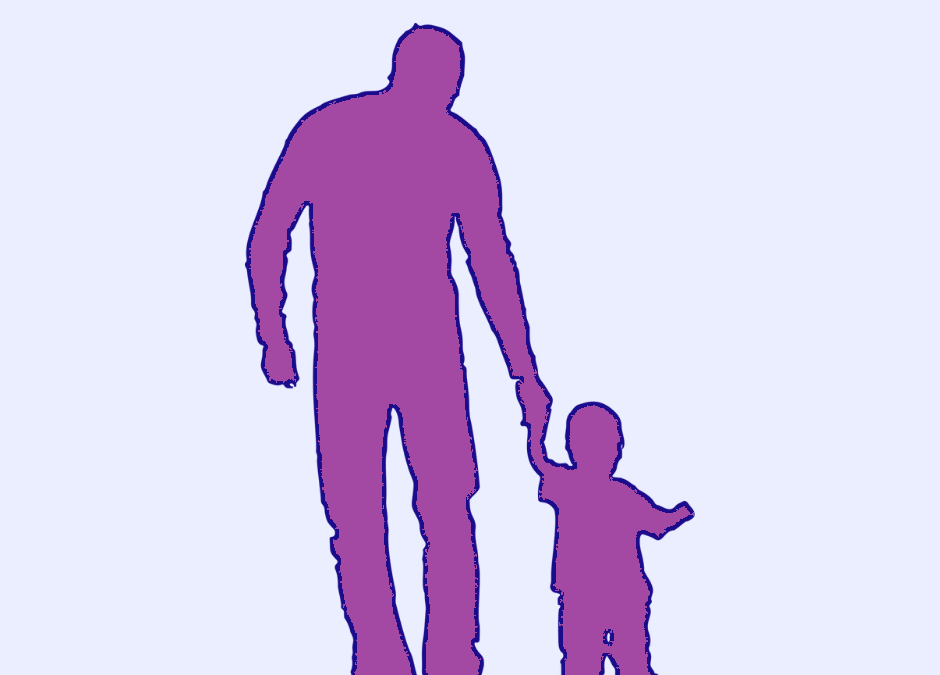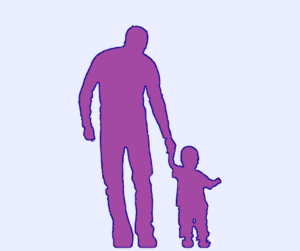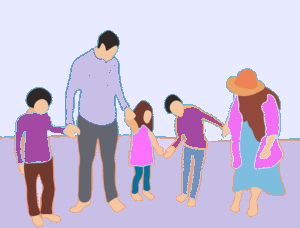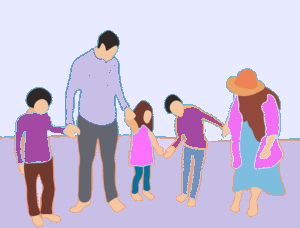 Aude de Villeroché est intervenue au cours d’une table ronde sur la thématique du lâcher-prise. Elle vous partage ici ses interventions autour d’un jeu de questions/réponses afin d’aider les parents à gérer leur charge mentale et à lâcher prise.
Aude de Villeroché est intervenue au cours d’une table ronde sur la thématique du lâcher-prise. Elle vous partage ici ses interventions autour d’un jeu de questions/réponses afin d’aider les parents à gérer leur charge mentale et à lâcher prise.
Cette table ronde était organisée dans le cadre du Sommet « Feel Good », initié par Céline Zemanczyk , spécialiste de la parentalité. Estelle Julien, experte en communication stratégique. Graziella Jofes, ludothécaire fondatrice et gérante de la ludothèque Récréajeux.
Comment faire pour lâcher prise sans que toute notre existence soit désorganisée ?
Pour lâcher-prise, il est essentiel :
- de choisir ses priorités,
- de relativiser l’importance des enjeux,
- d’accompagner ses enfants dans l’action.
Par exemple, il est important de considérer qu’ils ont besoin d’espace quand ils ont passé une journée à l’école.
On peut aussi réfléchir aux raisons qui nous poussent à formuler telle ou telle demande : est-ce pour se prouver qu’on est un super parent ? Pour le prouver à ses propres parents ? Ou est-ce bien réellement pour le bien-être de chacun ?
Comment prioriser les sollicitations de chaque membre de la famille ?
Afin d’aider les parents à gérer leur charge mentale et à lâcher prise, il faut déjà commencer par vous demander comment prioriser les sollicitations de chacun quand elles semblent toutes importantes tout en sachant qu’il faudra se garder un instant de répit que nous n’avons jamais ?
Il est essentiel de savoir exprimer son besoin et d’apprendre à la personne qui nous sollicite à différer sa demande si le moment n’est pas opportun.
L’anticipation et l’organisation sont les maîtres mots.
Il est également important de s’interroger sur l’autonomie que chacun peut gagner dans cette organisation.
Comment gérer ses émotions et celle de son entourage ?
Comment gérer les émotions de chacun (enfants d’âges différents et des parents) quand on est au bord de l’implosion ?
On peut parfois avoir le sentiment de mener une bataille perpétuelle pour que les enfants aillent à l’école ou encore pour qu’ils fassent leurs devoirs (qui leurs semblent idiots, inintéressants). On s’oblige à ne jamais rien lâcher car on sait que c’est pour leur bien et dans leur intérêt. Mais en contrepartie, on sent que la cocotte va exploser d’un côté comme de l’autre. On se force à ne pas rire pour ne pas hurler quand les enfants essaient de nous tromper, avec des essais systématiques et des stratégies de plus en plus élaborées.
Dans ce genre de situation, il est recommandé de s’isoler afin de récupérer à la fois son énergie et son calme avant de perdre patience.
Il est préférable de prendre du temps pour réfléchir à ce qui nous déborde. Parfois, on peut se rendre compte que ça n’est pas l’action de l’enfant qui peut nous mettre hors de nous mais le fait d’avoir eu trop de sollicitations au travail par exemple.
Il ne faut pas hésiter à parler de ce que l’on ressent à ses enfants ou bien encore à leur faire faire un exercice de relaxation sous forme de jeu, on peut aussi les inviter à réfléchir à une bonne solution pour eux et pour nous. En faisant cela, on les initie à une réflexion sur leurs besoins et les nôtres et on les invite donc à réfléchir à leur comportement et à son impact sur les autres. Ce sont des démarches d’autonomie de pensée qui leur serviront à d’autres occasions.
Si le rire nerveux s’empare de nous, ça n’est pas très grave ! L’essentiel est de réexpliquer ses priorités et ses attentes, ce qui créé de la connivence et de la confiance.
Comment impliquer les enfants petits et grands dans le lâcher-prise ?
Le lâcher-prise auprès des enfants petits (8 ans) et des adolescents (14-17 ans) va être différent.
Le plus important est avant toute chose de prendre du recul et de mettre la situation en perspective. Le problème est-il si grave que cela finalement ? Il ne faut pas oublier que la vie est un long fleuve, et que les enfants se construisent et évoluent chaque jour, peu à peu.
Pour l’enfant encore petit, afin d’éviter un sentiment de trop-plein, il peut être opportun de faire des activités avec lui par exemple.
En ce qui concerne les adolescents, l’écoute est très importante : apprendre à écouter ce qui est important pour lui et trouver des compromis. Lorsqu’on se montre trop rigide, le résultat obtenu est l’inverse de celui attendu.
Pour aider les parents à gérer leur charge mentale et à lâcher prise, je dirais également, que, contrairement à ce que l’attitude des enfants laisse parfois à penser, il ne faut pas oublier que la pression que l’on se met à soi-même, l’enfant et l’adolescent se la mettent également. Les enfants quoi qu’ils en disent parfois, ont à cœur de nous faire plaisir pour s’assurer de notre affection. Les enfants et encore plus les adolescents, ont aussi besoin de tester l’amour inconditionnel de leurs parents, par des provocations qui sont finalement juste des tests et re-tests pour savoir s’ils peuvent bien continuer à compter sur eux.
Comment peut-on se faire écouter sans crier ?
Pour cela, il est important de s’exprimer en posant sa voix et de créer un contact visuel avec l’enfant à qui on s’adresse.
Ensuite, on pourra déterminer ensemble l’organisation la plus adaptée à la situation.
D’autres conseils pratiques peuvent être appliqués :
- le prévenir en respectant le tempo de chacun,
- répéter les choses plusieurs fois,
- intégrer ses besoins dans nos horaires,
- ne pas le considérer comme en opposition par principe,
- lui parler tout doucement,
- changer le rythme de ses demandes pour créer de l’attention,
- créer du jeu.
Comment faire en sorte que les enfants rangent leur chambre ?
On leur a appris à ranger leur chambre et pourtant c’est toujours la même chose : on finit par le faire nous-mêmes car sinon c’est la catastrophe.
Il faut savoir que la notion de rangement peut être abstraite pour l’enfant. Pour la matérialiser et l’organisation, on peut par exemple découper le rangement en plusieurs tâches. Cela permettra à l’enfant de comprendre ce qu’il a précisément à faire et ainsi qu’il se sente moins submergé par l’ampleur de la tâche.
De plus, il faut également considérer que l’enfant ne se rend pas toujours compte du désordre dans lequel il est. Un enfant jeune réalise ce qui se situe dans son environnement immédiat et n’a pas de vue d’ensemble. C’est aux parents d’adapter leurs consignes au cerveau encore immature de leur tout petit. Même une consigne comme « mettre les jetons bleus avec les jetons bleus » demande une capacité d’identification et de tri qu’un tout petit ne maîtrise pas toujours. Réaliser cela vous permettra d’être à l’écoute du besoin d’apprentissage de l’enfant, et non dans l’agacement de ce qui n’est pas fait.
Enfin, il convient de redéfinir la notion de « catastrophe ». Ce désordre est-il quelque chose de grave au final ?
Comment gérer les mensonges des enfants ?
En premier lieu, il faut être sûr qu’il s’agit d’un mensonge et non d’une réécriture de l’histoire. Il est rare qu’un enfant mente délibérément avec l’intention de tromper l’adulte. Il réécrit l’histoire pour se préserver. L’enfant peut adopter ce comportement pour plusieurs raisons :
- pour échapper à l’angoisse,
- pour garder le contrôle,
- pour maîtriser une situation qui lui échappe.
L’inconvénient de parler de mensonge, de dire « il ne faut pas mentir » est que l’on se situe dans le domaine de la morale, du « c’est bien » ou « c’est mal ». Cela ne permet pas d’élaboration satisfaisante qui fasse grandir vos enfants. Accompagner l’enfant est préférable : lui demander comment il a vécu telle ou telle situation, étant donné qu’il préfère maquiller la réalité pour ne pas s’y confronter, permet de renforcer sa capacité à faire face. L’adulte peut l’aider à trouver des solutions dont il pourra s’emparer. Enfin, il est important de lui demander ce qui se passe pour lui quand il maquille la réalité et de lui faire prendre conscience qu’il est faillible, mais que ce n’est pas grave en soi. Cela permet de dépasser le simple « il ne faut pas faire ça », une injonction qui n’entraîne pas toujours d’adhésion positive de la part de l’enfant et peut faire passer les parents à côté du problème.
En conclusion, pour aider les parents à gérer leur charge mentale et à lâcher prise, il faut retenir que lâcher prise revient donc à bien identifier nos essentiels éducatifs en tant que parents, les besoins derrière ces priorités et enfin dépasser les événements auxquels nous sommes confrontés pour en faire des moments d’exploration pour outiller nos enfants, futurs adultes, dans la gestion de leurs propres émotions, peurs ou compétences